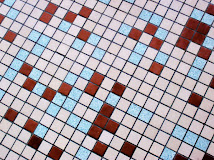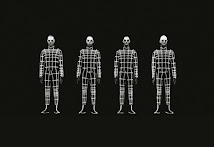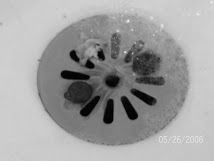Thomas est tout seul, un projet original de création littéraire.
Thomas est tout seul est un projet original de création littéraire où il vous est proposé de suivre en ligne et en direct la progression d'une (auto?) fiction.
L'un des objectifs de ce projet est de tester la possibilité d'un roman "participatif" intégrant l'avis ou le point de vue du lecteur dans le travail du rédacteur.
Vous êtes donc invités à prendre contact avec l'auteur-rédacteur afin de lui soumettre vos avis, souhaits, doutes ou suggestions. Ceci dans le seul but de faire exister Thomas et de déplacer la frontière entre la fiction et le réel.
Les différents textes à venir seront publiés dans leur ordre chronologique ("Jour 1", "Jour 2"...), prenez garde à ne pas lire les publications dans le désordre si elles se trouvent dans les archives, reportez-vous à la rubrique "libellés" qui fera office de sommaire.
Bonne lecture !
Céline Raux.
mercredi 1 octobre 2008
- THOMAS JOUR 12 -
jeudi 24 juillet 2008
THOMAS - JOUR 12 -
Mes voisins emmènagèrent en silence et ne devaient pas encore interférer, de quelque manière que ce soit, sur la monade solitaire que j'étais. Je ne les voyais pour ainsi dire jamais, hormis à deux ou trois reprises lorsque l'un des crânes d'oeufs indifférenciés devait réceptionner sur le trottoir d'en face des caisses de matériel pour le moins suspectes.
A part cela, tout était calme.
Trop calme.
D'une angoissante quiétude.
Même Hérvé semblait avoir disparu. Ses visites navrantes et inopportunes avaient cessé et l'appartement dans lequel je demeurai terré semblait s'être mu en une bulle lisse et invisible autour de laquelle glissaient tous les mouvements du monde sans que jamais ils ne m'atteignent. Et la courbe du temps elle-même m'aspirait dans un effroyable ennui doublé de maux de ventre sourds.
Mes recherches relatives au Grand Hominarium ne donnaient plus rien. En réalité, je flairai un échec latent que je croyais contourner par une baisse de ma motivation. Comme si l'illusion de me détourner de la fin que je m'étais fixée me protégeait de la réalité affligeante de cet échec auquel devait aboutir cette entreprise sans fin. J'étais Sisyphe en prise avec l'absurde et il me fallait croire qu'en me désintéressant de cet absurde il n'aurait plus d'empire sur moi. Ce qui devrait bien sûr s'avérer complètement faux et illusoire.
Une fine pellicule de poussière recouvrait maintenant mes fiches disposées en piles périlleuses sur mon bureau. Bon nombre d'entre elles devraient d'ailleurs rester vierge. Et défaire les paquets neufs de bristols ne provoquaient plus chez moi cette étrange exaltation. L'échec auquel je n'avais pourtant pas encore abouti m'apparaissait pourtant gros comme une maison et je savais que mon Grand Hominarium ne m'apporterait jamais de réponses à quoi que ce soit, que ce travail vain et infini n'avait pas les moyens de sa politique et que par conséquent, il ne ferait jamais sens. Et mon combat mental contre l’absurde serait une histoire sans fin à défaut d’être perdu d’avance.
Assis chez moi à me gratter le nombril, je ne faisais plus rien du tout. Le doute m’étouffait dans sa matière lourde et épaisse. Une vérité pourtant devenait évidente : alors que je croyais m'ouvrir aux autres, je m'isolais un peu plus chaque jour et je n'étais désormais plus rien qu'un petit point d'angoisse inconséquent perdu dans une grande ville indifférente.
Selon toute vraisemblance, et après une étude scrupuleuse de mon cas, je formulais l'hypothèse selon laquelle je déprimais gravement.
Le mot était donc lancé : dépression.
Cela pouvait avoir un certain charme, une certaine jouissance de la tristesse qui creuserait les contours de la vie à l'eau-forte, une tristesse à soi, existentielle et fine, aussi précieuse, en définitive, qu'un bonheur à soi. La dépression n'était pas sans évoquer la fougue désabusée et torturée d'un romantisme complaisant.
Mais je n'en étais pas là. Car je me sentais indigne de ma dépression et il était patent que je n'en tirerai rien de bon. Aussi, l'artiste maudit que je ne serai jamais -car mort-né dans la candeur placide de ma venue au monde- contenait toutes les promesses d'élévation et de grâce que je n'avais jamais pu tenir et que je voyais se dissoudre dans un horizon aussi lointain qu’inaccessible.
Plus rien n'allait. Arthur tournait en rond dans son bocal et je me sentais encore moins d'existence que lui.
Il y a d'abord eu ce cheveux blanc, puis l'écho silencieux de la solitude que même Hervé ne venait plus rompre. Il y a eu ensuite cette douleur originelle au nombril. Et le temps me transperçait sans que je parvienne à jouir des possibilités que m'offrait l'espace dans un monde en mouvement.
Le temps et le mouvement ne coïncidaient plus pour moi. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, j'étais l'incarnation vieillissante de l'inertie, une fausse-monnaie en stagflation. Et la banque mondiale ne voulait pas revoir à la baisse ses taux d’intérêt.
mardi 24 juin 2008
THOMAS -JOUR 11-
Le lendemain ne devait pas être une journée ordinaire. Après avoir passé plusieurs heures à me gratter le nombril, je me levai.
Morne, flasque et mou avec le jour de Venise de mon oreiller imprimé en bas-relief neo-classique sur ma joue gauche.
A peine mon pied venait-il de toucher le sol que je me sentai déjà minable.
Je me récitai pour moi-même la plus belle phrase du monde : "Le fond de l'air est frais" dans l'espoir vain et infondé qu'un peu de poésie me fît sombrer dans l'illusion d'un monde meilleur.
En vain.
Je demeurais perplexe.
Je me surpris pourtant à mener une réflexion inquiète sur la nature de ce fameux "fond" que l'on attribue à l'air en me disant que si même l'air avait un fond - est donc une limite - on réduisait déjà pas mal la dose de contingence dans le monde ce qui me procura un petit réconfort. Non que je sois en faveur d'un déterminisme total et absolu, cela s'en faut , mais j'aime autant mieux avoir des raisons de penser que tout ce gloubi-boulga qui frétille depuis le Big Bang, ça n'est quand même pas du grand guignol. Bref, si l'on pouvait éviter le Grand N'importe Quoi, je suis preneur.
Selon toute vraisemblance, le temps s'annonçait beau. Et déjà je m'alarmait de la platitude mes considérations atmosphériques.
N'empêche que les grues jaunes du chantier d'en face détachaient avec éclat leurs somptueuses strucutres d'acier du ciel bleu et que je me livrais toujours avec délectation à la contemplation de ce spectacle urbain.
Je soupirai finalement et m'arrachai une petite croûte qui s'était formée autour de mon nombril érubescent. Un peu de pus en profita pour se faire la belle. Ce spectacle me procura bizarrement une autre forme de délectation. Et le monde s'arrêta un instant autour de mon ombilic, preuve patente d'un lien originellement rompu, avec quoi, je ne saurais trop le dire.
Quoiqu'il en soit, cette petite cicatrice d'habitude si sage et si tranquille me grattait atrocement. Je ne sais pourquoi j'étais en proie à ce type de démangeaisons depuis plusieurs jours déjà.
Alors que j'étais en train de tamponner le pus de mon nombril avec un Kleenex, un vacarme digne des Tambours du Bronx résonna dans l'escalier.
Un camion de déménagement stationnait sous ma fênetre.
Selon toute probabilité, j'allai avoir de nouveaux voisins.
Une petite bulle de curiosité mêlée à de l'apréhension gonfla et monta légèrement en moi. Puis cette petite bulle éclata pour finalement laisser place à un étonnement d'un volume nettement supérieur.
Quatre grands crânes d'œuf athlétiques et altiers sortirent du camion. Tous portaient d'étrange combinaisons noires en matière synthétique qui n'étaient pas sans rappeler les combinaisons en peau de requin dont se parent les nageurs olympiques de l'ère post-moderne. Les mêmes lunettes de soleil en polycarbonate leur barraient le visage. Ils m'évoquaient tour à tour les androïdes de mon enfance ou quelques figures sorties tout droit d'un comics de Marvel. Leur insolite dégaine les plaçait quelque part entre Spiderman et le Surfeur d'Argent, la planche en moins. Mais je devais songer qu' ils pouvaient tout aussi bien être quelques extraterrestres, membres d'une secte ou d'une organisation occulte qui ayant eu vent de mes travaux sur l'espèce humaine chercherait par tous les moyens à mettre la main dessus afin de déjouer un complot d'ampleur international à ce point comprommettant que, de par leurs fonctions, ils se verraient conduits à la nécessité de me faire la peau et de jeter mon coprs dans l'acide pour qu'aucune trace ne subsiste.
Mon nombril s'affola et je renversai la moitié de la Béthadine par terre.
Avec précaution, j'observai vaillamment.
Les crânes d'oeufs accordaient leurs gestes et leurs déplacements avec précision et d'une rigueur à ce point mécanique que je doutai un instant de leurs origines terrestres. L'analogie avec une vitrine d'horlogerie suisse me traversa la tête mais aucun coucou ne leur sortait de la bouche.
Sur leur camion de déménagement, on pouvait lire en grosse lettre cette indication tout à fait hermétique : Kling Klang Record - Kraftwerk.
Ce qu'il nous faudra plus tard considérer comme un évènement d'importance majeure venait tout juste de se produire.
dimanche 11 mai 2008
LE MONDE A-T-IL BESOIN DE MOI ?
LE MONDE A T IL BESOIN DE MOI ?
L’individu ne peut exister que s’il évolue dans un monde qui seul peut lui signifier son existence. L’homme prend parfois l’apparence d’une pièce de puzzle : abstrait et inutile lorsqu’on le prend isolement, rempli de sens et de raisons d’être lorsque toutes les autres pièces du jeu s’accordent pour lui faire corps. L’homme hors du monde est une pièce de puzzle hors de sa boîte, c’est à dire un non –sens a priori.
Mais que se passe-t-il s’il n’existe pas de puzzle mais seulement une accumulation arbitraire de pièces sans rapports les unes autres parce que découpées au hasard ? Autrement dit, que se passe-t-il si le monde n’existe pas au-delà de moi ? La réponse est que je m’en fais un mien, que je force sur les autres pièces du puzzle pour les contraindre au mieux de faire corps avec moi et que je me bats pour triompher de l’absurde et me faire prouver mon existence et le sens de celle-ci. Que le monde transcende mon moi et l’on peut dire ceci : il s’approprie mon existence à mon insu pour alimenter la sienne. Que mon je transcende le monde et l’on peut dire ceci : je m’approprie un monde pour combattre l’absurdité par l’affirmation de mon existence, alors seulement je peux dire moi.
Mais laquelle de ces conceptions est la bonne ou du moins la meilleure, cela reste une question cruciale qui sans forcement trouver de réponses met en exergue le problème récurrent de la relation du moi avec le monde. Car, s’il est évident qu’un monde est le seul univers de contradiction qui peut affirmer l’existence de mon moi et que donc, j’ai besoin du monde cela ne me dit pas si le monde, lui, à besoin de moi. Ainsi, que suis-je pour le monde ? Un accident, un imprévu, une occasion ? ou bien le maillon d’une chaîne, une pièce du puzzle ou même, pourquoi pas, son barycentre ? Le monde ne dépend-t-il que de la conception que je m’en fais où est-ce qu’il me dépasse et me conçoit lui-même ?
La question est vaste, obsédante dès qu’elle se pose et peut-être sans réponse. D’où l’angoisse de l’individu qui se tourmente sur le sens de son existence et qui effrite ses anciennes certitudes. La question n’est plus « qui suis-je ? » mais que représente mon moi dans ce tout, dans cette globalité enveloppante qu’est le monde.
Ainsi, pour tenter de tracer l’ébauche d’une réponse à cette problématique, il est nécessaire de d’abord s’interroger sur le concept de monde et du moi en tant qu’être-dans-le-monde. Puis dans un second temps, il s’agit de voir quel rôle le moi peut-il espérer remplir dans le monde avant de s’interroger sur l’angoissante hypothèse de ma superficialité au monde.
*
Etant donné qu’il n’y aurait pas de sens à vouloir étudier la relation du monde au moi sans savoir ce que recoupent les deux termes, il faut étudier les concepts.
D’abord, pour ce qui est du monde, précisons ce qu’il n’est pas, et ce avec quoi on est parfois susceptible de le confondre. Le monde, ce n’est pas l’univers car l’univers est infini, abstrait car impossible à se figurer, alors que le monde est plutôt fini et perceptible par l’Homme (comme l’ont montré Descartes, Kant et Leibniz). Le monde n’est pas non plus un « milieu » car il est autre chose qu’un espace donné dans lequel sont placés des corps, il doit être un horizon de sens pour la conscience. Bien entendu, il ne s’agit pas ici d’envisager le monde selon un sens physique ou planétaire car en l’occurrence, la question que l’on se pose n’a pour ainsi dire pas de rapport avec une science empirique. Il faut comprendre le monde tel que l’individu le perçoit au quotidien, c’est à dire dans un certain mode de relations aux choses et à autrui. L’homme vit sur terre mais existe dans le monde.
De là l’idée d’un être-au-monde qui marque le refus de séparer le monde intérieur du monde extérieur et qui souligne le fait que le monde en général est d’abord cette structure de sens visée par l’homme comme horizon de son action, de ses projets avant d’être un objet de connaissance. Pour
La deuxième question à se poser porte sur le moi. Qu’est-ce que le moi ? Le moi ne recouvre pas une réalité aisément identifiable car il ne renvoie ni à une donnée palpable, ni à une abstraction. En effet, il n’y a pas un moi ou des moi mais seulement moi qui suis unique en même temps qu’insaisissable. Lorsque Descartes dit : « Je pense donc je suis » son je s’exprime isolément du monde n’évoquant que la certitude de la conscience de son être. En revanche, lorsque je dis moi, j’affirme mon je au-delà des autres et je sous-entends qu’il y a aussi un toi, un lui, un nous ou un eux. Le moi est un je qui s’est ouvert au monde, à autrui ou du moins qui en a pris conscience. Mais le moi ne s’identifie pas au monde au point de se fondre avec lui. Quand ce moi dit « je veux » il ne dit pas « nous voulons » et pourtant il fait partie du monde, si bien que le moi apparaît souvent comme un solitaire très entouré.
Dans la théorie freudienne, le moi est « une fraction du ça » qui a dû se modifier sous l’influence du monde extérieur. Privilégiant le principe de réalité par rapport au principe de plaisir, le moi remplit essentiellement une fonction de médiateur en s’efforçant de concilier les intérêts contradictoires du ça et du sur-moi, tout en tenant compte du monde extérieur. Parce que le moi doit constamment négocier entre ma vraie nature et le monde, il apparaît quelque peu inadapté au monde et son adaptation (lorsqu’elle réussit) est forcée par les contingences extérieures comme l’éducation ou la pression sociale qui se joue sur l’altérité.
Ainsi, le moi est une individualité qui affirme sa personnalité en excluant les autres de la représentation qu’elle se fait d’elle-même au sein de cet horizon de sens et d’altérité qu’est le monde.
Maintenant que les concepts ont été éclaircis, il s’agit de voir quel rôle le moi peut-il espérer remplir dans le monde dans l’hypothèse où le monde aurait effectivement besoin de moi.
En quoi est-il permis de supposer que l’absence de moi constitue un manque pour le monde ? Si l’on considère le monde indépendamment de la représentation qu’un moi s’en fait, la première hypothèse est aussi la plus évidente : le concept de monde n’a pas de sens si on lui soustrait le nombre de personnalités qui le compose, de même que la boîte du puzzle est vide de sens lorsqu’on la vide de ses pièces où que la boîte à outil n’existe que par les outils qu’elle comporte. En effet, le monde n’existe pas s’il n’y a personne pour le concevoir. Le monde a donc besoin d’une multitude de différents moi pour s’appeler monde mais quel besoin pourrait-il en avoir d’un seul en particulier, c’est là le mystère. Le monde a besoin du concept mais peut être pas de sa réalisation effective individuelle en une seule conscience ou personnalité. Ici, le moi ne doit donc pas être assimilé ou confondue avec une personnalité. De même que l’océan se constitue d’eau mais qu’il n’en demeure pas moins océan si on en retire une goutte et de même que la plage demeure plage si on lui retire un grain de sable. Mais il n’en va pas de même pour le puzzle. En effet, même si le puzzle comporte des millions de pièces, l’absence d’une seule le rend inexorablement imparfait. Or le but du puzzle est justement la perfection de son assemblage, la cohérence de ses imbrications et la finalité de ce qu’il était initialement censé représenter (un puzzle de la tour Eiffel n’est conçu pour rien d’autre que la représentation finale de cette tour Eiffel) et voilà pourquoi le monde tient plus de l’océan que du puzzle : parce qu’il ne s’oriente vers aucune finalité apparente et qu’il est nécessairement imparfait. De fait, le moi n’est qu’une occasion pour le monde, un instant, quelque chose d’éphémère et d’interchangeable, peut être un hasard bien que la réalisation de son concept est nécessaire au monde.
D’autre part, il est possible de concevoir le monde autrement que comme une entité qui me transcende, à laquelle j’appartiens malgré moi. On peut en effet concevoir le moi comme unique créateur du monde qu’il s’est fait. Dans ce cas, le monde correspond à la perception que le moi s’en fait, à une représentation. C’est à dire que le monde n’est rien d’autre que ce qu’il est pour moi, et qu’ainsi ce monde est une conception unique appartenant à celui qui la crée pour lui-même. Le monde correspond alors à la vision qu’a le moi du monde, et il est impossible de retrouver cette vision à l’identique chez deux moi différents.
Or s’il le monde ne correspond qu’à une perception relative à chaque moi, il est logique que le monde ainsi perçu et conçu par ce moi ne peut exister sans lui. Ce qui prouve que dans ce cas bien précis, et si l’on s’accorde pour affirmer que le monde ne me transcende pas mais que, au contraire, il est issu de moi, alors ce monde ne peut se passer de moi. C’est un monde subjectif, peut être le seul qui existe, qui est impensable sans moi, le moi défini est son unique condition d’existence.
Nous avons donc essayé d’établir les conditions dans lesquelles le monde a effectivement besoin de moi pour exister. Dans le premier cas, le moi est un sujet indispensable du monde qui le transcende mais ce moi-là n’a aucune prétention à la subjectivité puisque le monde le considère pareil à ses semblables. Dans le second cas, c’est le moi qui transcende le monde et qui le fait exister par la représentation qu’il s’en fait. Essayons de voir maintenant dans quels cas envisageables le monde apparaît plus comme une mise à l’épreuve de la subjectivité et comment est-ce qu’il peut faire prendre conscience au moi de son insignifiance, de la médiocrité de sa condition et peut être parfois lui donner le sentiment de sa superficialité (ou inanité).
L’une des raisons majeures qui peuvent conduire à penser que le monde n’a pas besoin de moi est qu’il apparaît souvent comme un système habile à pratiquer le rejet.
Le moi ne peut jamais réellement se fondre dans le monde, sa subjectivité participe à son objectivité sans que les deux ne s’interpénètrent vraiment au point de faire corps, de faire qu’un. Le monde n’est pas un : c’est une somme de subjectivité + un concept objectif. Le problème du moi est qu’il est incapable de se révéler complètement au monde autrement que dans la folie au tel cas, le monde le rejette parce qu’il n’aime pas les fous. Le passage à l’affirmation totale d’un soi est une souffrance. Le moi est condamné, pour subsister dans le monde, à de perpétuelles et fatigantes concessions entre son ça (freudien) le plus profond et le monde extérieur, d’où un continuel déchirement et la souffrance du moi qui se force à imposer sa place dans le monde sans jamais parvenir vraiment à s’y adapter. C’est le cas de toutes les pièces de puzzle écornées et souffrant d’une quelconque imperfection, mais peut-on trouver un seul moi parfait en ce sens qu’il s’intègre tout naturellement dans le monde ? Sûrement pas. Le moi souffre de son hétéronomie au monde, c’est inscrit dans sa nature et lorsqu’il n’arrive pas à surmonter cette souffrance et cette inadaptation, le moi mesure la somme d’incompréhension qu’il y a entre lui et le monde, et c’est l’angoisse. L’angoisse du moi qui réalise que l’objectivité du monde à laquelle il participe n’est en fait qu’une somme d’imperfection et de subjectivités dissemblables qui ne parviennent jamais à l’harmonie et à une sereine homogénéité. L’unicité du monde se comprend dans l’hétéronomie des moi et souvent, le moi désespère car il souffre de cette hétéronomie en même temps qu’il ressent la douleur qu’il y a à s’assumer comme un être parfaitement autonome incapable d’évoluer parmi les autres autrement qu’en se barricadant dans son monde intérieur qu’il lui sert de refuge. D’où une dissonance récurrente entre le monde et moi, lequel essaie constamment de compenser son mal-être en acceptant d’interminables concessions avec l’autre (cf., théories sur la dissonance cognitive en psychologie).
Le monde m’impose l’altérité. Elle est heureuse lorsque j’y participe, douloureuse et destructrice si le moi voit les autres s’émanciper sans lui. C’est toujours l’autre qui impose sa loi et qui décide pour moi de mon isolement ou de mon intégration. C’est l’autre qui décide de mon utilité au puzzle ou qui pose la pièce au rebut. Le moi ne dépend que du bon vouloir du monde dans lequel il s’est échoué, il doit s’imposer au monde s’il veut exister, autrement le monde le fait sombrer dans l’oubli lui rappelant par-là son insignifiance et son interchangeabilité.
Si l’on prétend que le monde a besoin de moi au sens où ce moi est une donnée existentielle et « vitale » de ce monde, que dire de ceux à qui l’on ôte le sentiment d’existence et de ceux qui ne perçoivent ce sentiment d’existence qu’à travers le rejet qu’elle inspire et l’impitoyable mise à l’épreuve qu’est capable de lui infliger le monde aussi bienfaisant que cruel. C’est le cas des sans domiciles fixes par exemples, ces moi vagabonds qui n’existent plus, désolidarisés du monde, pièces de puzzle mise au rancart et qui ont perdu leur existence en même temps que leur rapport à l’autre, que leur rapport au monde. C’est le cas de ceux qui suicident parce qu’ils n’ont pas trouvé leur place dans ce monde ou qui n’ont jamais réussi à la pénétrer parce qu’on ne voulait peut être pas de lui. Le monde est le pire système d’exclusion que peut subir un moi qui ne parvient pas à faire masse dans le tout. Il n’y a que le monde pour empêcher à un moi le sentiment d’exister dès lors qu’on ne le reconnaît plus comme un autre mais qu’on ne le reconnaît plus du tout. Les conditions d’existence du moi sont les mêmes conditions que celles de sa non-existence et si le moi commence par être dans le monde, il court le risque de sa mise à l’écart et de se retrouver alors face au monde comme isolé dans la prison de verre qu’il a dressée autour de moi.
*
THOMAS - JOUR 10 -
J'étais terriblement tracassé. Comme j'avais voulu en avoir le coeur net, j'avais remis à Hervé un exemplaire du questionnaire du Grand Hominarium. Je le priai de le remplir au plus vite afin de me faire savoir son point de vue sur l'ensemble des questions. Prévenant ou saisi d'une mauvaise intuition, je ne saurais dire, je lui laissais un délai large de plusieurs jours.
Parcourant des yeux le feuillet que je lui avais tendu, Hervé eut d'abord l'air profondément contrarié par la nature des questions. Soit qu'il n'en comprit pas la teneur, soit qu'elles constituassent une insulte patente à son pouvoir d'érudition. Il aurait sans doute préféré un QCM portant sur le développement historique du calcul infinitésimal. Cependant il fut d’accord pour me rendre le questionnaire préalablement rempli d’ici trois jours.
Ces trois jours furent pour moi l'occasion de récolter quelques specimen rares et d'importance majeure au sein de la population. Je pourrais citer quelques fiches qui sont là, devant moi, sur mon bureau. Il y a par exemple les fiches de Mademoiselle S., Monsieur Q., ou Madame Z. mais aussi Mademoiselle L. Mais de ces trois journées ne me restait au fond qu'une inquiètude sourde. Le spectre d'Hervé planait dans les rues, semblait se cacher derrière chaque visage. Je me torturais l'esprit pour savoir s'il allait oui ou non réussir à remplir la fiche du Grand Hominarium. Je me formulais à moi-même la terrible hypothèse : Hervé me rendant copie blanche.
Et mon projet d'en prendre un sacré coup.
En effet, si nous reconnaissons un tout quand une multiplicité d'objets forme une unité ou entre sous un acte unique de la pensée, ce tout ne saurait comporter de "résidus". Or si Hervé devait demeurer inclassable au regard des autres specimens du Grand Hominarium ou autrement dit, si Hervé ne pouvait s'insérer dans AUCUNE catégorie de la totalité humaine cela devait vouloir signifier qu'il fut possible qu'il existât des "résidus" (aussi cruel et insoutenable que puisse paraître le mot). Ou que peut être le genre humain échappait à toute définition et que l'humanité n'était qu'un concept flou. Peut être que je me fourvoyais dans l'absurde sans même m'en rendre compte. Ou peut être que l'humanité c'était qu'un bordel de grain de sables sur une plage. Peut être que qu'il n'y avait pas de puzzle. Peut être qu'il n'y avait jamais eu de puzzle. Peut être que nos vies sur terre c'était "placement libre" comme au cinéma. Peut être qu'on n'a pas de siège réservé et que ça va à qui mieux-mieux. Peut être qu'Hervé était un résidu à l'écart du tout. Peut être que rien n'avait de sens et peut être qu'il n'y avait pas de résidus. Ou peut être qu'il n'y avait ni tout, ni parties, ni règles, ni exceptions. Ou que si ce Tout c'était véritablement l'énorme Tout de la terre entière, de l'univers et de milliards d'étoiles, je veux dire le Tout absolu, alors il n'y avait pas de résidus non plus.
Peut être que mon Grand Hominarium ne valait pas une bille.
Peut être que je m'étais-je planté.
Peut être que j'étais un con.
Peut être que je n'étais pas une pièce de puzzle mais ce foutu grain de sable. Peut être même que j'étais un grain sur leur putain de puzzle. Ou alors peut-être que j'étais la seule pièce d'un puzzle qui n'existe pas au milieu de la plage de la Grande Motte.
J'étais peut-être un résidu. Au fond, je ne pouvais pas savoir dans la mesure où je ne pouvais pas encore en apporter le démenti. Peut être que le monde n'avait pas besoin de moi. Après tout, ce n'était pas parce que certaines fleurs rares disparaissaient qu'on déplorait la fin de la faune et de la flore. Mais quand même. La disparition d'une fleur devait toujours pour moi rester un évènement tragique.
En même temps, une petite voix accompagnait chacune de mes considérations. Elle me disait de me méfier car avec ces histoires de résidus qui rentrent pas dans la totalité, j'étais à deux doigts de devenir un putain de fasciste. Cette idée me provoqua une nausée profonde et un mal de ventre aigu. Mais je me sentais égaré. Je passais une nuit blanche, peuplée de tourments.
mercredi 23 avril 2008
THOMAS - JOUR 9 -
Le surlendemain, j'étais parvenu à me trouver en possession d'une douzaine de fiches. Que des bleues et des roses. La rencontre avec le troisième type n'avait pas encore eu lieu, ce qui était dommage parce que je remarquai qu'en réalité les gens se ressemblaient tous plus ou moins et qu'en règle générale, ils partageaient les mêmes préoccupations : 1- argent ou 1-famille ou 1-travail ou 1-famille
2- travail 2-argent 2-famille 2-travail
3- famille 3- travail 3-argent 3-argent
ou 1-argent ou 1-travail
2-famille 2-argent
3- travail 3-famille
Nota bene : pour les célibataires souffrants, la catégories "famille" devient "trouver l'homme/la femme de ma vie."
Mais cela ne devait pas m'inquiéter outre mesure. Après tout, le manque de diversité peut être patent même dans un puzzle. Comme lorsqu'on doit reconstituer un ciel et qu'on a affaire qu'à des pièces bleues. A ce moment-là, on ne peut compter que sur leurs formes pour les distinguer. Pour le reste, c'est kif-kif bourricot, bonnets blancs et blancs bonnets. Je repensai à Madame Rosa ainsi qu'à Sandra. Deux spécimen rares et d'importance majeure. Toutes deux cultivaient à leur manière de réelles aspirations, authentiques en ce sens qu'elles ne les poursuivaient que pour elles-mêmes et non pour quelque autre raison inessentielle ou contingente. Elles avaient toutes deux été profondément sincères. Rien dans leur choix ne se laissait guider par des déterminations extérieures. Ni l'une ni l'autre ne m'avait parler d'argent, de traites ou de loyer. Ni l'une ni l'autre n'avait évoqué ce désir fou de garer un jour un break dans l'allée du lotissement pour y caser des gosses et un labrador. Ni l'une ni l'autre n'avait fait part de son désir latent de bouffer son voisin pour gravir plus vite l'échelle sociale. A l'inverse, j'avais l'impression que la plupart des gens n'avaient plus d'idéaux comme si leur élan vital s'était mu en satisfaction passive de plaisir de supermarché. Les gens étaient repus. Ils n'avaient plus faim. Ils ne cherchaient donc plus à combler le manque. Ils s'ingéniaient seulement à se fabriquer de nouveaux désirs. Madame Rosa et Sandra étaient des électrons libres. Pas des rouages d'un système bien huilé.
Ma pensée tournait en rond et cela ne me menait nulle part. J'allumai une cigarette, comme ça pour voir. Mais une fois de plus, la fumée que j'avais inhalée devint aussitôt plaques de fontes dans ma tête. Tout cela n'eut pour effet que de me plonger dans une brume plus épaisse. L'odeur du tabac me fit l'effet d'un relent de cave. J'ouvris en grand la fenêtre pour humer l'air frais du matin. Accoudé au garde-fou, je dominai tant bien que mal la situation. Je jetai un coup à l'intérieur du salon et je vis qu'Arthur méditait sagement dans son bocal. Je lui trouvai un air circonspect. Il paraît que ce n'est pas correct de dire qu'un poisson affiche un "air circonspect". Mais je vous assure qu'Arthur communique parfois de véritables expressions, parfois même des mimiques. Arthur n'est pas comme les autres poissons. Il pense et reçoit des affects. La plupart des gens ne le croirait pas et prendrait du plaisir à dire que je suis fou. Mais encore une fois, il faut se rendre à l'évidence : les gens sont bourrés de préjugés. Et je sais qu'Arthur souffre de ceux dont sont victimes ceux de son espèces. Par exemple, nous nous obstinons à appeler "poisson rouge" ce petit vertébré non tétrapode dont l'écaille est en réalité de couleur orange, voire dorée quand des photons de lumière illuminent son écaille. Or, quand on ne dit pas la vérité c'est un mensonge. Et ça, ce n'est pas correct du tout. C'est toujours très vilain de mentir parce qu'alors, il se trouve toujours quelqu'un pour être trompé. Et s'il s'en rend compte, eh bien à ses yeux, on n'est plus digne de confiance. Et ça, c'est très très grave. Comme de se trouver une mauvaise excuse pour un travail qu'on a pas fait ou qu'on a rendu en retard. Considération morale qui me fit me rappeler la présence significative d'un manuscrit émaillé de fautes d'orthographes en attente sur mon bureau. Et que si je ne voulais pas sortir une excuse bidon à mon patron qui l'attendait de pied ferme, il fallait que je m'y mette de toute urgence. J'y vis une incitation au travail salarié.
Sauf qu'on sonna à l'interphone.
A peine avais-je eu le temps de m'asseoir à mon bureau qu'il me fallait déjà me relever. Malheureux évènements impromptus qui empêchent le besogneux de s'atteler à sa tâche...
Je décrochai le combiné de l'interphone. Une friture épouvantable me vrilla le tympan.
"Oui ?
- C'est Hervé, me répondit une voix de vieil aspirateur. Je peux monter ?
- Tu peux monter.
- Alors je monte ?
- Alors tu montes.
- Tu m'ouvres ?
- Je t'ouvre."
Déjà je regrettai ce choix que je classai d'emblée dans la catégorie des"pas judicieux", mais le fait est que j'ai toujours eu du mal à dire non.
Je pressai le bouton de l'interphone. Un long Si mineur enroué grésilla dans l'appareil et salua l'arrivée d'Hervé dans le hall de l'immeuble.
Quand Hervé et sa canadienne taupe prirent place dans le rotin de mon salon, je ressentis une désagréable sensation de déjà vécu. Je me demandai aussitôt si toute ma vie durant je serai obligé de chaque fois revivre ces visites ponctuelles qui par leur répétition agaçante me donnaient systématiquement l'impression de ne pas avoir avancé d'un pouce d'une semaine sur l'autre. Peu importaient les évènements ou la couleur du ciel, chaque fois Hervé, fidèle à lui-même, franchissait le seuil de mon appartement, il me semblait que je revenais au point mort. C'était d'autant plus désagréable que c'était vrai. Il faut être honnête, j'étais toujours au point mort. Et quand par acharnement je réussissais à passer une vitesse, voilà que je calais. Que je repassai au point mort. Et qu'Hervé me rendait visite.
C'était d'un mécanisme navrant.
Le seul changement notoire mais mineur (et donc sans grande probabilité d'incidence sur le cours des évènements) était qu'Hervé avait selon toute vraisemblance négligé de se raser depuis plus de trois jours. De plus, il avait recouvert sa calvitie d'un bonnet péruvien marron qui disséminait des peluches d'alpagas dans tout le salon au moindre courant d'air. Deux petits cordons de laine terminés par des glands prolongeaient la coiffe et pendaient lamentablement sur ses joues creuses. On aurait juré qu'il s'était vissé un de ces vieux abat-jour en macramé sur la tête. La raideur naturelle de son corps figé contribuait pour une bonne part à ce que l'on confonde Hervé avec un vieux lampadaire de dépôt-vente.
Hervé était d'humeur loquace. Il me servit un long monologue sur sa mère, son allocation chômage, les trains express régionaux, une chronique de France Culture, l'héliocentrisme de la Renaissance, la composition de la Vache qui rit et le messianisme de Joachim de Flore. Après quoi, sans doute à court de munitions, il marqua une pause. Mais dans l'épais silence qu'il avait malgré lui installé, il ne put s'empêcher de lâcher ce nouvel obus :
"Est-tu d'avis qu'il faut reconnaître un statut ontologique au concept d'angoisse?"
Je me levai et me dirigeai vers le réfrigérateur. Je pris une petite brique de Cacolac. Une de ces petites briques où le petit sachet plastique d'une paille se trouve collé sur le rebord. Je me munis également de mon bloc-note que j'avais laissé sur la table de la cuisine. Je revins dans le salon où Hervé se tenait encastré dans le rotin. Il avait profiter de mon absence pour saisir mon Rubik's Cube qui traînait par-là. Il avait la mine réjouie du type qui a réussi à en reconstituer toutes les faces en moins de trois minutes. Le trait rouge de ses lèvres plates s'était courbé et élargi. Phénomène physiologique qui signifie "sourire".
"Sais-tu combien d'algorithmes de résolution il existe pour un cube de vingt-quatre facettes par côté, demanda Hervé en exhibant mon Rubik's Cube comme s'il s'était agi d'une pièce rare.
- Aucune idée. Tiens, je t'ai ramené un Cacolac."
Il saisit la brique. Détacha la paille et sembla prendre un certain plaisir à la planter dans la petite opercule en aluminium. Il but d'une traite et aspira par la paille jusqu'à ce que les six faces de la brique se rétractent dans un bruit de carton plié.
" Naturellement, on sait que le couronnement des Éléments d'Euclide est la construction des cinq polyèdres réguliers, ce qui, en substance, revient à la détermination des groupes finis de rotations dans l'espace à trois dimensions."
Craquement de rotin.
"Hervé, finis-je par demander, je peux te poser une question ?"
Il cillat.
"Oui.
- Je me demandai, c'est quoi ton aspiration fondamentale dans la vie ?"
Il cillat. Il cillat encore. Il cillat une troisième fois. Il contorsionna sa lèvre inférieure avec une moue bizarre.
D'une voix traînante il articula cette demande de précision :
"Parles-tu de cette notion développée par Kurt Lewin qui permet l'analyse de l'influence du succès ou de l'échec sur les conduites ? Au tel cas il faut savoir que la motivation est un construct qui s'opposerait à l'intelligence ou à l'aptitude."
Rester calme et pondéré. Rester calme et pondéré. Rester CALME et PONDERE.
Hervé est mon ami. Hervé est mon ami. Hervé est mon ami et je ne m'énerve pas. Je ne m'énerve pas parce qu'Hervé est mon ami.
Calme. Courtoisie. Pondération.
Hem.
Pour ne pas paraître désagréable, j'enrobai ma voix de toutes les fioritures ayant contribué à la gloire de l'art baroque :
" Non, Hervé. C'est beaucoup plus simple que ça. Je voudrais simplement savoir vers quoi est-ce que tu orientes chaque jour tout ton être. De quelle manière est-ce que tu souhaites actualiser au mieux les potentialités de ton essence ?"
Je faisais autant d'efforts pour me faire comprendre que si je parlais à un sourd. Une furtive étincelle traversa son regard. Il répondit enthousiaste :
" Le Savoir Absolu.
- Hein ?
- Mon esprit tend vers le savoir absolu tel qu'il fut célebré par Hegel.
- Et ça te mène où, demandai-je interloqué."
Il marqua une pause puis finir par répondre d’un ton neutre :
"Absolument nulle-part."
Il me fallait chasser un doute. Je poursuivis prudemment :
"Et ta couleur préférée ? Laquelle c'est ?"
Cette question interloqua Hervé :
"Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi, diantre, devrai-je avoir une couleur préférée ?
- Tout le monde a une couleur préférée, retorquai-je.
- Alors par induction tu crois que j'ai certainement une couleur préférée ?
- C'est probable en tout cas.
- Mais pas nécessaire.
- Si tu le dis.
- Mais quelles raisons irrationnelles aurai-je de préférer telle couleur au regard de telle autre ? Quels sont ces enfantillages ?
- Alors tu reconnais ne pas avoir de couleur préférée ?
- Je n'ai pas de couleur préférée. Je suis un animal rationnel, moi."
Je ne savais pas trop si c'était rationnel ou pas d'avoir une couleur préférée, mais quoiqu'il en soit, ça me parassait humain et pas du tout insensé. Par exemple, moi j'aime bien le rouge parce que c'est une couleur dynamique qui donne du peps. Et je n'aime pas le rose car cela me fait toujours penser aux romans de Barbara Cartland que je trouve abominables. Et quand je regarde le soleil qui se couche à la campagne un soir d'hiver et que je contemple cet horizon où le ciel plein d'une douce et chaude lumière dévoile ses palettes de rouge, d'orange, et de rose (pas le même que celui de Barbara Cartland cela s'entend) et que toutes ces couleurs, déclinées en une infinité de nuances, s'accrochent à quelque nuage d'altitude comme un trait de pinceau tendu sur la toile, quand le bleu de la nuit s'assombrit pour mieux faire jaillir cette magnifique explosion de couleurs et de lumières, quand tout rougeoit et que les ombres s'allongent dans les prés, et bien quand ce spectacle s'offre à moi je ne peux m'empêcher de penser que s'il est permis aux hommes de contempler tant de beauté, c'est qu'il doit y avoir une certaine quantité de bien qui fait se mouvoir le monde. Et en même temps, je me demandais s'il est un homme qu'un tel spectacle aurait laissé parfaitement insensible.
Mais il en existait au moins. Il s’appellait Hervé. Il n'aimait rien tant que réfléchir. En conséquence, il n'avait goût à rien et ne désirait rien.
Chaque fois, Hervé suscitait en moi d'intenses refléxions sur le genre humain. Je commençais à être traversé par d'horribles doutes que je chassai pour un temps de mon esprit.